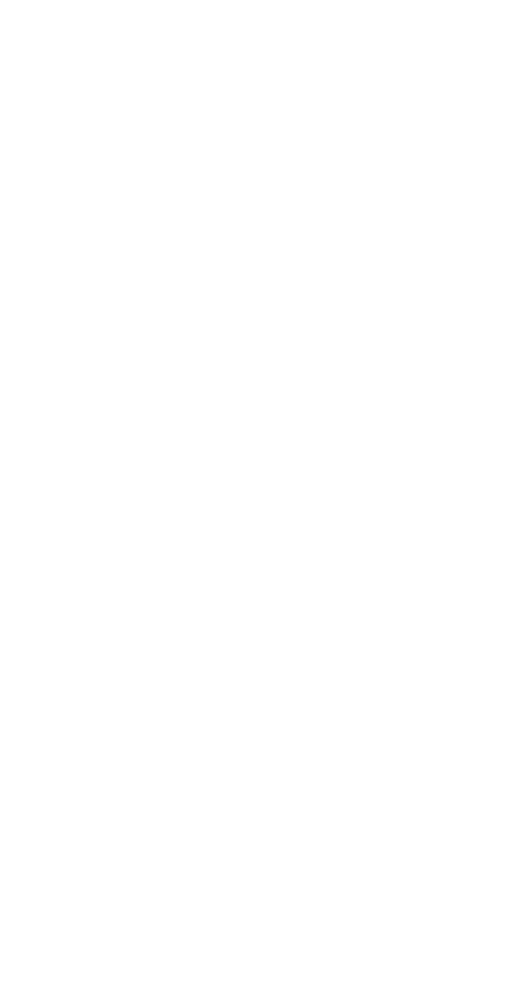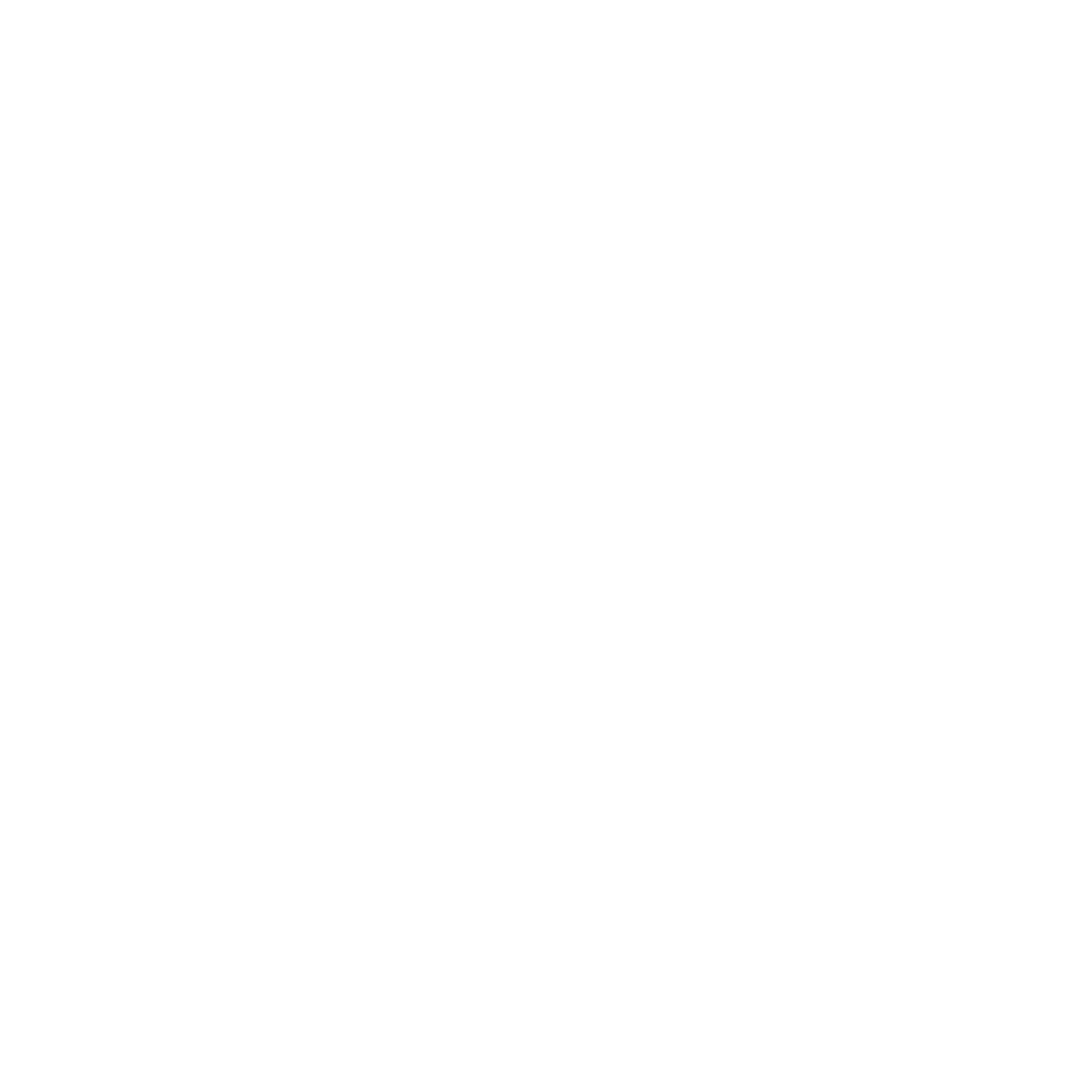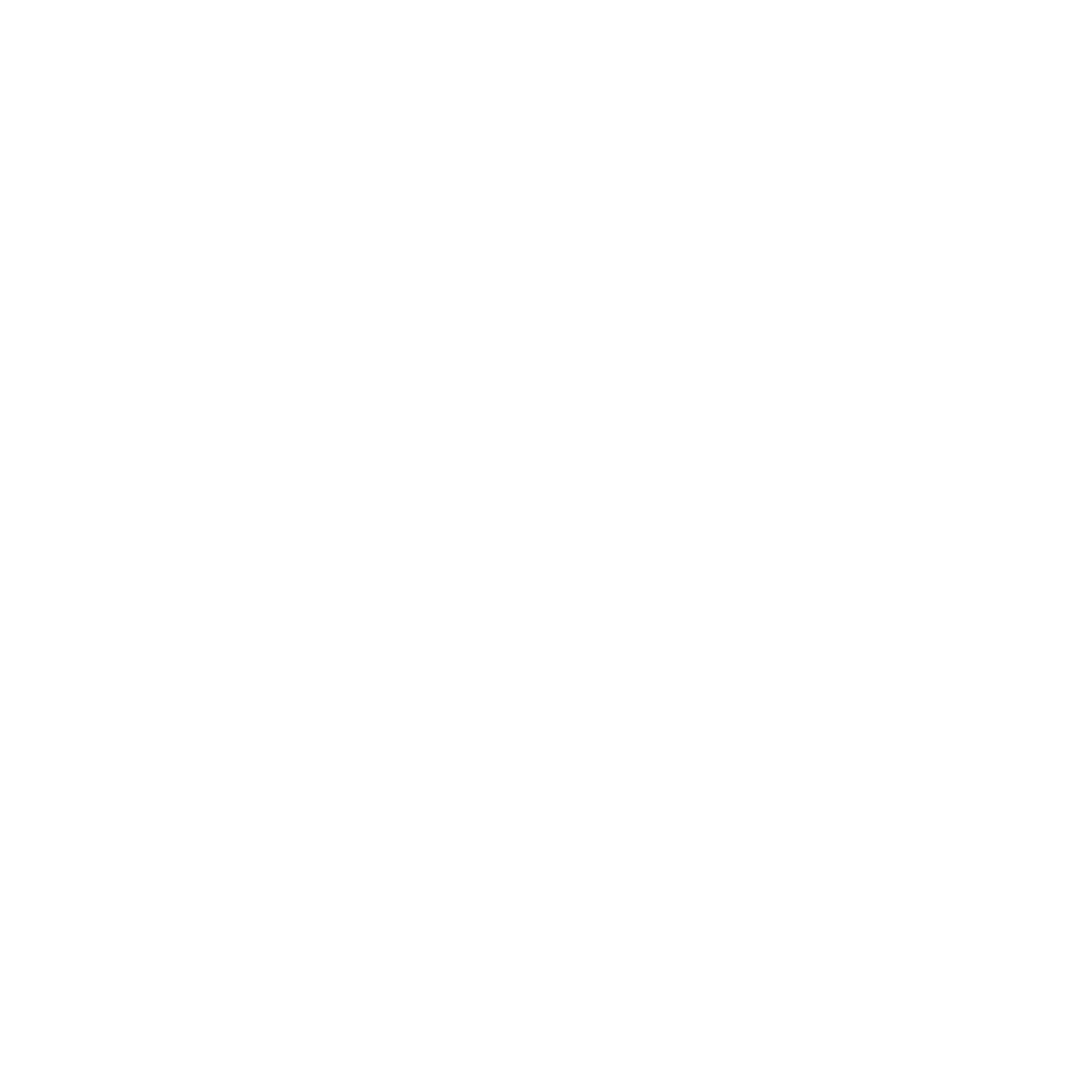HISTORIQUE ET PATRIMOINE
Sains-en-Gohelle est une commune française située dans le département du Pas-de-Calais en région « Hauts de France ». Elle fait partie de la Communauté d’Agglomération de Lens-Liévin qui regroupe 36 communes et comptait 244 561 habitants en 2010.
ETYMOLOGIE : D’après le dictionnaire topographique du Pas-de-Calais, voici les plus anciennes graphies de notre Commune : « Seins » en 1190, « Sains » en 1226, « Villa de Sanctis » en 1274 et « Sains-en-Gohelle » en 1789. Ce village est connu au 11ème siècle. En possession de Sains William de Sanctis. Ce mot est exprimé en latin par Sanctum, Santis, Villa de Sanctis. La façon d’utiliser ce nom dans les anciens titres nous permet de déclarer que l’origine vient de pèlerinages qu’on y faisait en l’honneur de certains saints dont les reliques étaient là déposées. Cette étymologique est préférable à celle qui fait venir le nom de tous les villages du Pas-de-Calais (Sains-les-Pernes, Sains-les-Fressins, Les Marquions, Sains-en-Gohelle, à l’exception toutefois de Sains-les-Hautecloque qui tire son nom de Senores, tribu celtique venue se fixer dans ce village) du Celtique Sin (Bois Forêt). D’ailleurs, c’est l’opinion de Monsieur DAUZAT basée sur celle généralement admise, d’après GODEFROY (dictionnaire de l’ancienne langue française 1385).
GOHELLE : Gauharia en 1154 ; Goiele en 1230 ; Gauhère en 12546 ; Gauhièra en 1257 ; Gohiele en 1273 ; Goeria en 1300 et Gohelle en 1378. La Gohelle (désignant un taillis) serait donc une région couverte de taillis. C’est une opinion parfaitement défendable.
LA SEIGNEURIE : Gauharia en 1154 ; Goiele en 1230 ; Gauhère en 12546 ; Gauhièra en 1257 ; Gohiele en 1273 ; Goeria en 1300 et Gohelle en 1378. La Gohelle (désignant un taillis) serait donc une région couverte de taillis. C’est une opinion parfaitement défendable.
LES PLAIDS : Le terme était employé au pluriel : on parle des « plaids » d’une seigneurie dans une communauté d’habitants. Cette assemblée se tenait dans l’aula de la demeure seigneuriale, et réunissait les tenants ou tenanciers, propriétaires officiels des tenures composant une seigneurie (c’est-à-dire ceux qui rendaient l’hommage). Dans les petites seigneuries, les tenanciers désignaient parmi eux un prévôt chargé de faire exécuter les décisions de l’assemblée, conformément au droit coutumier local.
Par la suite, le terme de plaid est utilisé à propos de la réunion (simple assemblée ou audience) des habitants d’une communauté, à la demande du Seigneur, chaque année; On tenait alors des « plaids banaux » ou « plaids annaux ».
Les archives départementales de quelques départements ont quelques fois conservé les procès-verbaux de ces plaids. Ils renseignements précieusement sur la vie des campagnes, en particulier pour les XVIIe et XVIIIe siècle.
Au 18ème siècle, ils se tenaient au Blanc Fossé. Fond de Sains.
LES GUERRES : Sains ne semble pas avoir souffert de la guerre de 100 ans. La chronique de Bresin 1880, donne la liste des villages d’Artois dévastés en 1472-1475, Sains n’y figure pas. En 1475, De Longueval qui tenait un fief à Sains, demande qu’il soit exempté des impôts à cause de la dévastation de ses biens par les troupes en guerre. A cette date, la plupart des villages de l’Artois furent brûlés et détruits. Les habitants emmenés prisonniers, le bétail enlevé ainsi que leurs biens. Tout le comté du longtemps inhabité.
CAHIERS DE DOLEANCES : Les cahiers de Sains et de Bouvigny ne furent jamais retrouvés. Ces deux localités dépendaient du baillage secondaire de Lens. Il eût été intéressant de connaître les avis des habitants de Sains, certainement influencés par le conventionnel voisin et l’abbé Behin, curé et député d’Hersin.
LA POPULATION : Sains comptait, d’après les archives 22 feux (foyers) soit environ 100 habitants en 1414 et 21 feux (environ 95 habitants) en 1469 (d’après André Bocquet, Recherches sur la population rurale de l’Artois et du Boulonnais pendant la période bourguignonne : 1384-2588, Arras, Commission Départementale des monuments historiques, 1969). 200 habitants en 1789 ; 800 habitants en 1860 (ouverture des mines de Noeux) ; 1000 habitants en 1890 ; 3700 habitants en 1905 ; 3300 habitants en 1914 ; 3917 habitants en 1936 ; 4097 habitants en 1946 ; 4518 habitants en 1954 ; 5200 habitants en 1957 : 5248 habitants en 1962 ; 5430 habitants en 1968 : 6031 habitants en 1995. En 1999, la population s’étend à 6084 habitants.
SUPERFICIE : Sains compte une superficie de 554 ha et se compose de 18 km 500 de voies.
SON EXTENSION : En 1750, Sains ne comptait que les maisons du Bout d’Amont. En 1800, apparaissent quelques maisons du petit Sains, en 1860, des constructions nouvelles voient le jour tout le long de la rue nationale et la rue de la mairie, ainsi qu’autour de la Tour Eiffel ; à partir de 1900, la cité 10 et de nombreux commerces (rue Nationale, du Prince, Ville Fond de Sains) sortent de terre. En 1925 émerge la nouvelle cité et en 1958 celle des Castors. Les H.L.M. et de nombreuses maisons particulières seront construites quelques mois plus tard.
LA GUERRE 1914-1918 : Sains, situé à quelques kilomètres de Notre-Dame de Lorette, eut beaucoup à souffrir des bombardements incessants. On déplore de nombreuses victimes civiles et maintes dévastations. Près de 300 de ces enfants tombèrent au champ d’Honneur. Les cimetières militaires de la localité témoignent de la violence des combats.
L’OCCUPATION 1939-1945 : Ses blessures à peine pansées, la guerre 1939 fut déclarée. Notre commune peut se vanter de n’avoir jamais collaboré et tous, suivant leurs moyens, résistèrent à l’occupant. Bombardée deux fois en mai 1940 (la Mairie fut détruite en Août 1943) Sains déplore la disparition de plusieurs soldats, de victimes innocentes et la mort lente de quelques dizaines de ses meilleurs combattants de la résistance dans les camps de Dachau et autres.
MONUMENTS HISTORIQUES : L’Eglise Saint-Vaast (16ème sicèle) vocable : la vierge. Le colombier (18ème siècle).
COMPOSITION DE LA MEDAILLE D’HONNEUR : L’écu surmonté du Blason des comtes d’Artois est barré d’une écharpe, limitant sur la senestre un arbre déraciné, symbole de la Gohelle (1378) plaine coupée de taillis. Sur la dextre, des coquilles Saint-Jacques symbole des pélerinages qu’on y faisait en l’honneur de certains Saints dont les reliques étaient là déposées. Les ornements extérieurs concrétisent les activités de la Ville de Sains-en-Gohelle : les deux rivelaines : l’extraction de la Houille ; l’épi de blé : l’Agriculture et le rameau d’Olivier : signe de Paix. La croix de guerre 1914-1918 a été remise à la Ville de Sains-en-Gohelle le 25 Septembre 1920 en Hommage National.
CIMETIÈRE MÉDIÉVAL, RUE LAMARTINE : Le site fouillé au 227, rue Lamartine à Sains-en-Gohelle correspond à l’extension sud de l’occupation médiévale fouillée par Archéopole (dir. H. Assémat) début 2008. Dans le cadre de l’aménagement du lotissement « Chemin de campagne » par la société AGEA, l’équipe d’Archéopole avait en effet caractérisé un site daté de la fin du haut Moyen Âge constitué de deux aires funéraires de 400 et 270 m2 associées à des structures artisanales et agricoles de part et d’autre d’une grande voie d’axe sud est-nord ouest. L’aire cimetériale la plus grande était aussi la plus dense avec un individu par mètre carré. C’est cette aire qui se poursuit sur la parcelle de M. Sébastien Petit au 227, rue Lamartine.
L’équipe d’Archéosphère (dir. C. Beauval) a fouillé les 480 m2 de l’emprise du projet de construction d’une maison (moitié est de la parcelle) pendant 8 mois avec une équipe de 12 à 27 personnes. 1262 structures archéologiques ont été recensées caractérisant essentiellement une chapelle et une aire funéraire (1167 fosses) ayant fonctionné du haut Moyen Âge à l’époque moderne. Deux silos ont également été découverts : le premier est totalement arasé et le second est un grand silo d’un volume de 14 m3.
La problématique de cette fouille s’articule autour de l’implantation de la nécropole, de son fonctionnement, et de son évolution en cimetière en relation avec l’édification d’une chapelle.
Les jalons chronologiques sont peu nombreux. À de rares exceptions, les défunts sont inhumés sans aucun mobilier d’accompagnement. Les quelques tessons de céramique et les fragments osseux découverts dans le comblement des tombes sont des dépôts résiduels qui ne reflètent que des activités périphériques. En revanche, les nombreux recoupements d’une part, et les modifications des modes d’inhumations et de l’architecture des tombes d’autre part, nous donnent de précieux éléments de phasage.
La plus ancienne trace d’occupation date de la Tène D2. Il s’agit d’une monnaie bellovaque dite Bronze au lion (détermination J.-M. Doyen) découverte dans le comblement d’une sépulture. Deux monnaies antiques du début du IIIe siècle et de la fin du IVe siècle de notre ère ont aussi été découvertes dans des contextes similaires.
Les premiers éléments directement associés aux structures datent de fin VIIe–début VIIIe siècle. Il s’agit de deux monnaies anglo-saxonnes et de deux fibules en forme de croix et décorées d’ocelles (étude M. Brunet). Ces objets sont associés à des défunts inhumés sur le dos, les bras en extension, dans de grandes fosses rupestres. Trois dates 14C réalisées par Beta Analytic sur les individus des sépultures 112, 736 et 1050 de même architecture funéraire, couvrent aussi les VIIe et VIIIe siècle. Les tombes sont alors organisées en rangées orientées nord-sud. Dans une de ces tombes, nous trouvons le seul dépôt intentionnel : un pot globulaire placé près de la tête et contenant des charbons de bois (étude L. Alonso).
Les trous de poteaux caractérisant l’implantation d’un premier édifice en bois recoupent certaines de ces sépultures. Ce bâtiment repose sur six poteaux au moins et est orienté N106°. Il est possible qu’un chevet en bois plus étroit jouxte cet ensemble à l’est. S’il a existé, ce chevet est remplacé dans la première moitié du IXe siècle au plus tard par un chœur carré posé sur des fondations en craie damée formant ainsi une chapelle à chevet plat. Dans ce chœur, deux individus orientées N20° et N30°, têtes au sud, sont inhumés sur le dos les bras en extension.
À ce moment semble apparaître un nouveau mode d’inhumation où les défunts sont déposés dans des tombes anthropomorphes, les mains sur le pubis ou l’abdomen.
Puis cet édifice subit une nouvelle transformation. Une nef se développe à la place de la partie en bois. Des murs maçonnés de 120 cm d’épaisseur embrassent les murs du chœur. Une abside est accolée à l’est du chœur qui, par ailleurs, est consolidé par deux piliers internes au nord et au sud. Le nouvel édifice mesure 18 m de longueur pour 8 m de largeur. Sa construction est terminée au plus tard au début du XIe siècle. Les tranchées de fondation ont recoupé des tombes (rectangulaires ou anthropomorphes) dont les os ont été ré-inhumés dans un grand ossuaire situé au centre de la nef.
Cette période correspond au maximum d’utilisation de l’aire funéraire. Les défunts sont toujours inhumés dans des tombes anthropomorphes, mais l’orientation générale des sépultures est influencée par la direction de la chapelle. À l’extérieur des murs, l’organisation générale des tombes est difficile à percevoir. Nous n’observons plus d’alignement en rangées mais constatons une intensification des inhumations le long des murs, notamment autour du chœur. Au sein de la nef, les fosses sont creusées dans la partie périphérique, à l’exception d’une sépulture double au centre de cette dernière. C’est en association dans une tombe anthropomorphe datée du XIe ou du XIIe siècle que nous avons découvert le seul endotaphe en place. Deux autres inscriptions ont été recueillies dans les comblements de deux autres tombes. Ces tablettes sont taillées dans de la craie blanche, la plus grande mesure 127 x 100 x 25 mm. Deux de ces pièces ont été découvertes au chevet de la chapelle et la dernière est située dans la partie sud de la nef. Au moins deux indiquent l’inhumation de prêtres, la dernière reste toujours énigmatique. Nous pouvons aussi rattacher les tombes en coffrage en pierre à cette phase. C’est également à cette période que le grand silo est creusé au nord ouest de la nef. Ce dernier a fait l’objet d’aménagements successifs dont témoignent des cuvelages en bois.
À partir du XIIIe siècle, les inhumations de très jeunes enfants se multiplient. Ils sont particulièrement abondants le long des murs de la nef, à l’intérieur comme à l’extérieur.
Au cours du XIVe siècle se développent les inhumations en cercueil. Les défunts sont alors souvent inhumés avec les mains posées sur le thorax. Les alignements de tombes sont encore visibles, parallèles ou perpendiculaires aux murs de la chapelle. À l’intérieur de la nef, les cercueils sont enterrés dans la partie centrale. Un corps est enterré dans le chœur de l’église (SP 198), c’est la troisième et dernière personne à bénéficier de ce privilège.
Les dernières inhumations sont pratiquées en pleine terre, les corps étant protégés par un linceul. Les épingles ont une tige de 15 à 30 mm de longueur et une tête constituée d’un fil enroulé autour d’une extrémité, formant 2 à 2,5 spires. Certaines tiges sont étamées. Ces épingles sont connues à partir du XIIIe et deviennent fréquentes au XVe siècle. Une datation 14C nous donne un âge compris de la fin du XVe siècle au début du XVIIe siècle.
Ainsi, l’aire funéraire aurait fonctionné pendant près d’un millénaire. Les individus inhumés correspondent à une population paroissiale, même si le recrutement semble se modifier au cours du temps. L’apparition des très jeunes et des périnatals au cours du XIIIe siècle pourrait être mis en relation avec le développement du phénomène du répit. La taille de ce cimetière (plus de 1500 individus sur les 1100 m2 fouillés par les deux équipes de fouille) paraît très importante au regard des données d’archives (22 feux à Sains en 1422). Il faut donc imaginer un recrutement en dehors des limites de la paroisse. D’après son cartulaire, l’abbaye de Saint-Aubert-de-Cambrai devient titulaire d’un autel à Sains seulement à partir de 1146 et, dans le partage de la dîme, aucune mention n’est faite d’un lieu de culte vers l’actuel Petit Sains. Cependant, les cartes du XVIIIe siècle attestent de la présence d’une chapelle à l’emplacement de notre découverte. Sur la « Carte d’Artois et des environs, où l’on voit le ressort du Conseil Provincial d’Artois », réalisée en 1704 par Guillaume de l’Isle est mentionnée une « chapelle de Sains ruinée ». Cette chapelle ruinée apparaît également sur des cartes de 1711, 1713, 1740 le long de l’axe principal entre Arras et Béthune.
Par ailleurs, le cadastre napoléonien pourrait avoir conservé les traces de l’enclos paroissial relatif à notre église (parcelles 313, 314, 315, 316). Celle-ci se situe à peu près à égale distance des bordures de ces parcelles. Par le canon 10 du XIIe Concile de Tolède (681), le périmètre d’asile ecclésiastique est fixé à trente pas autour de l’édifice consacré. Progressivement, on assiste à une affirmation du caractère funéraire de cette espace avec une matérialisation par de véritables enclos à partir de la fin du Xe siècle. On aurait ainsi la délimitation d’une aire sacrée dans laquelle s’inscrit l’espace cimetérial. Un fossé mis au jour par l’équipe d’Archéopole pourrait correspondre à l’une des limites de l’aire funéraire. Dans cette hypothèse, le cimetière de la rue Lamartine à Sains-en-Gohelle serait fouillé sur moins de la moitié de sa superficie.